14400
BAYEUX
14 - BAYEUX
Tapisserie de Bayeux
(cavaliers Bataille d'Hastings)

Tapisserie de Bayeux (cavaliers Bataille d'Hastings)
En vente
|
14400 |
14 - BAYEUX Tapisserie de Bayeux (cavaliers Bataille d'Hastings) |
|
| 2017 |
 |
|
| 2019 | ||
|
Tapisserie de Bayeux (cavaliers Bataille d'Hastings) |
||
|
En vente |
||
|
14400 |
14 - BAYEUX Tapisserie de Bayeux |
|
| 2003 |
 |
|
| 2004 | ||
| 2006 MDP | ||
| 2007 | ||
| 2008 EVM | ||
| 2009 EVM | ||
| 2010 EVM | ||
| 2011 EVM | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2019 | ||
|
Tapisserie de Bayeux |
||
|
En vente |
||
 La Tapisserie de Bayeux, aussi connue sous le nom de tapisserie de la reine
Mathilde, et plus anciennement « telle du Conquest » (pour « toile de la
Conquête ») semble avoir été commandée par Odon de Bayeux, demi-frère de
Guillaume le Conquérant. Elle décrit les faits relatifs à la conquête de
l'Angleterre en 1066. Elle détaille les événements clés de cette conquête,
notamment la bataille de Hastings. Il faut toutefois noter que près de la moitié
des images relatent des faits antérieurs à l'invasion elle-même. Bien que très
favorable à Guillaume le Conquérant, la Tapisserie de Bayeux a une valeur
documentaire inestimable pour la connaissance du XIe siècle normand et anglais :
elle nous renseigne sur les vêtements, les châteaux, les navires, les conditions
de vie de cette époque. Conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans le trésor
de la cathédrale de Bayeux, elle est aujourd'hui présentée au public dans un
musée qui lui est entièrement dédié.
La Tapisserie de Bayeux, aussi connue sous le nom de tapisserie de la reine
Mathilde, et plus anciennement « telle du Conquest » (pour « toile de la
Conquête ») semble avoir été commandée par Odon de Bayeux, demi-frère de
Guillaume le Conquérant. Elle décrit les faits relatifs à la conquête de
l'Angleterre en 1066. Elle détaille les événements clés de cette conquête,
notamment la bataille de Hastings. Il faut toutefois noter que près de la moitié
des images relatent des faits antérieurs à l'invasion elle-même. Bien que très
favorable à Guillaume le Conquérant, la Tapisserie de Bayeux a une valeur
documentaire inestimable pour la connaissance du XIe siècle normand et anglais :
elle nous renseigne sur les vêtements, les châteaux, les navires, les conditions
de vie de cette époque. Conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans le trésor
de la cathédrale de Bayeux, elle est aujourd'hui présentée au public dans un
musée qui lui est entièrement dédié.
La Tapisserie
de Bayeux n'est pas, à proprement parler, une tapisserie ; en effet, elle relève
de la broderie, de huit teintes naturelles de laines sur des pièces de lin bis.
Elle mesure environ 70 mètres et a été confectionnée entre 1066 et 1082,
peut-être en Angleterre pour décorer le palais épiscopal de Bayeux. Elle est
divisée en une série de panneaux, d'une longueur totale de soixante-dix mètres
pour une hauteur de cinquante centimètres. De par sa présentation, sous formes
d'images distinctes, on a pu y voir l'ancêtre de la bande dessinée, mettant en
scène 626 personnages. Cependant, le fait que, suivant les spécialistes, il y
ait de 30 à 70 images distinctes relativise ce point de vue. Chaque scène est
assortie d'un commentaire en latin.
Six cent
vingt-six personnages, deux cent deux chevaux et mules, cinq cent cinq animaux
de toutes sortes, trente-sept édifices, quarante-neuf arbres… Au total, mille
cinq cent quinze sujets variés fournissent une mine de renseignements sur le XIe
siècle.
Si une
majorité d'historiens s'accorde à penser que c'est bien Odon qui commanda cette
broderie pour orner la nef de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Bayeux,
inaugurée en 1077, la discorde règne encore quant à qui la fabriqua. La légende
dit que c'est la reine Mathilde, aidée de ses dames de compagnie, qui la
fabriqua ; pour d'autres, elle fut fabriquée, soit dans le Kent, soit à
Winchester, dans le Hampshire, vingt ou trente ans après les événements qu'elle
relate. Toutefois, les dernières recherches de l'Université de Caen, réunissant
des sommités archéologues, historiens, médiévistes, s'accordent à penser que la
« Broderie d'Hastings » a été faite dans le Kent, à Winchester ou à Canterbury,
tout de suite après la bataille elle-même, et sa confection aurait duré deux ans
environ. C'est ce que Denise Morel et Marie France Le Clainche font vivre dans
leur roman Les Brodeuses de l’Histoire, où elles mettent en scène l'atelier de
broderie de Winchester. Nous savons, en effet, que cet atelier rassemblait
brodeurs et brodeuses, laïcs et religieuses, anglo-saxonnes, normandes et
bretonnes.
La première
moitié de la broderie relate les aventures du duc Harold Godwinson, beau-frère
du roi Édouard le Confesseur, dont le navire fit naufrage sur les terres du
comte Guy de Ponthieu (dans la Somme actuelle) en 1064. Il fut sauvé et capturé
par Guy qui envisageait de le libérer contre rançon. Hélas, un espion de
Guillaume, visible sur la broderie, était là. Guillaume exigea de Guy qu'il lui
remît Harold, ce qui fut fait. Guillaume adouba Harold chevalier à Rouen. C'est
lors de cette cérémonie, qu'on voit sur la broderie, que Harold jura, sur les
reliques d'un saint (très important à l'époque) à Guillaume de le soutenir pour
succéder à Édouard sur le trône d'Angleterre. Il revint sur cette promesse plus
tard, ce qui lui valut son excommunication par le pape. La broderie montre
ensuite Harold retourner en Angleterre et se faire acclamer roi après la mort
d'Édouard.
La broderie
reflète le point de vue normand de l'histoire, notamment en justifiant
l'invasion de Guillaume par sa légitimité au trône. Harold y est représenté
comme un fourbe, parjure, reniant un serment sacré, alors qu'il semble que l'on
ne trouve de relation de ce serment que dans la tapisserie et dans la Gesta
Guillelmi de Guillaume de Poitiers, une autre source normande, écrite peut-être
dix ans après la conquête normande de l'Angleterre. Cela dit, on s'accorde
généralement à penser que ce serment eut bien lieu mais qu'il y aurait peut-être
eu tromperie, puisque Harold aurait affirmé qu'il ne savait pas qu'il y avait de
saintes reliques sous le livre sur lequel il jura.
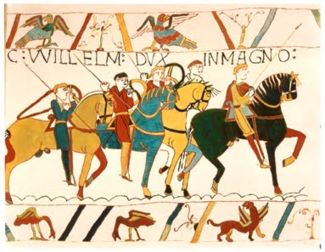 Ensuite, sur la broderie, nous voyons les préparatifs de Guillaume pour son
invasion de l'Angleterre ; puis des images de la bataille d'Hastings. À ce
sujet, on a longtemps cru que Harold y était représenté mourant d'une flèche
dans l'œil, mais on pense, de nos jours, qu'il y a eu confusion sur la personne,
le frère d'Harold étant mort d'une flèche dans l'œil.
Ensuite, sur la broderie, nous voyons les préparatifs de Guillaume pour son
invasion de l'Angleterre ; puis des images de la bataille d'Hastings. À ce
sujet, on a longtemps cru que Harold y était représenté mourant d'une flèche
dans l'œil, mais on pense, de nos jours, qu'il y a eu confusion sur la personne,
le frère d'Harold étant mort d'une flèche dans l'œil.
La broderie
contient aussi une représentation d'une comète, probablement la Comète de
Halley. La mention de cette comète est entièrement justifiée, car elle devait
justement passer à cette époque.
On peut
également noter que les éléments figurant dans les parties hautes et basses de
la broderie ne semblent pas avoir de rapport avec le principal récit. Ainsi, on
peut voir par exemple dans la partie basse de la tapisserie une scène du corbeau
et du renard de Virgile.
Toutefois, à
la fin de la broderie, lorsque la bataille entre Guillaume et Harold fait rage,
les motifs décoratifs de la frise du bas disparaissent, et la frise se remplit
des cadavres des morts et des boucliers et armes tombés à terre, comme si ce «
débordement » devait traduire la fureur des combats, impossibles à contenir dans
la zone du milieu de la tapisserie.
La broderie
nous apporte une connaissance quant à des faits historiques dont nous avons peu
de trace par ailleurs. Sa présentation, sous forme d'images, la rendit, tout au
long des siècles, accessible à tous alors que peu savaient lire.
La broderie
est inestimable quant à la connaissance de la vie de l'époque ; d'abord sur les
techniques de broderie du XIe siècle, notamment l'apparition de ce qui est nommé
depuis le point de Bayeux ; ensuite sur nombre de techniques de l'époque,
puisque y apparaissent des constructions de châteaux, de bateaux (la flotte
d'invasion de Guillaume). Y figurent aussi des vues de la cour de Guillaume, de
l'intérieur du château d'Édouard, à Westminster. Nous y voyons nombre de
soldats, ce qui a permis de se faire une meilleure idée de leur équipement.
Ainsi, sont bien visibles des signes distinctifs sur les boucliers, ce qui était
peu répandu jusqu'alors. Toutefois, les soldats y sont représentés se battant
mains nues alors que toutes les autres sources écrites de cette époque font
apparaître que les soldats se battaient (et chassaient) presque toujours
gantés.
La broderie a
traversé les siècles jusqu'à nous de manière chaotique. Elle fut pendant
plusieurs siècles exposée à Bayeux, avec des périodes de troubles durant
lesquelles elle fut cachée, notamment durant la Révolution française. Au XIXe
siècle, elle fut l'objet de nombre d'études scientifiques et d'une restauration
achevée à Bayeux en 1842, suite à quoi elle fut exposée sous verre. Elle fut à
nouveau cachée pendant la guerre franco-prussienne de 1870 puis durant la
Seconde Guerre mondiale.
À l'heure
actuelle, elle est exposée au Centre Guillaume le Conquérant, à Bayeux.
![]()
|
Renseignements d'ordre général
Musée de la Tapisserie de Bayeux Site internet : www.tapisserie-bayeux.fr Email : formulaire de contact sur le site Ouverture du site |
Comment s'y rendre VPC de la (des) médaille(s) au statut en vente OUI
Chèque à l'ordre de "Trésor Public" |