84 - VAISON-LA-ROMAINE
Office de tourisme
![]()
84 -
VAISON-LA-ROMAINE
Office de tourisme
![]()
Vaison-la-Romaine (en provençal: Vaison selon la norme classique
ou Veisoun selon la norme
mistralienne) est une commune française, située dans le département de Vaucluse
et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les
Vaisonnais. La commune est située sur la partie nord du département, en dessous
de l'Enclave des Papes. Environ 35 km d'Orange, 50 km d'Avignon, 10 km des
Dentelles de Montmirail et 40 km du Mont Ventoux. La commune fait partie du
"pays Voconce".
|
Le théâtre
antique
Sa construction
date très probablement du Ier siècle de notre
ère, sous le règne de l’empereur Claude ; sa décoration ayant été
enrichie au début du siècle suivant. Conformément aux recommandations
préconisées par l’auteur latin Vitruve dans son traité sur
l’architecture, le théâtre fut creusé dans le flanc nord de la colline
de Puymin qui offrait une masse rocheuse et
une pente propices à une telle installation. Néanmoins un énorme travail
de taille et de reprise de la roche a été nécessaire pour réhabiliter à
la fois des gradins réguliers et l’assise des maçonneries. Restauré au
cours du IIIème siècle, le théâtre fut probablement utilisé jusqu’au
début du IVème siècle. Les historiens avancent l’hypothèse qu’il fut
détruit au début du siècle suivant, au moment du décret d’Honorius (en
407) qui ordonnait dans toutes les provinces de renverser, de briser ou
d’enfouir les statues des divinités païennes. C’est peut-être dans ce
contexte que l’on jeta dans les parties les plus profondes du théâtre,
les effigies des empereurs et des autres divinités qui ornaient le mur
de scène. C’est également à partir de cette même époque que l’on
commença à utiliser les grandes assises du monument soit comme
sarcophages, soit comme matériaux de construction. Le travail de
destruction et d’oubli fut si complet qu’au début de la Renaissance il
ne restait du monument, que deux arceaux, signalés à diverses reprises
par les savants et les voyageurs. Il faut attendre le XIXème siècle et
la mise en place au niveau national d’une structure visant à inventorier
les monuments de France pour que le théâtre suscite à nouveau un
intérêt.
C’est ainsi que dans le cadre des recherches menées sur les monuments antiques du Vaucluse, en 1821, le dessinateur Chaix identifie le théâtre. Les premiers travaux de dégagement furent entrepris à partir de 1838 par la Commission des Monuments historiques. Ils furent suivis par de nouvelles recherches très dévastatrices pour le site, mais qui permirent aussi d’importantes découvertes. |
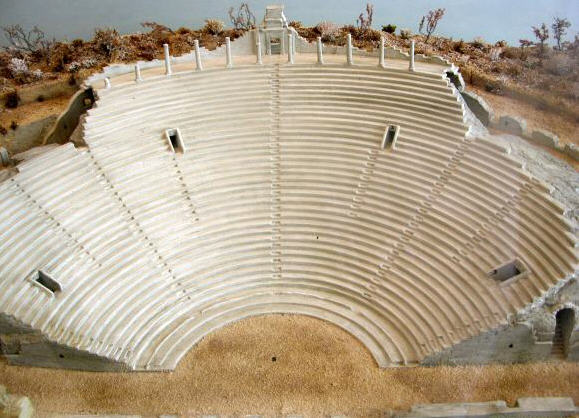 |
En
1903, un nouveau projet allait mettre à mal l’intégrité des vestiges. La ligne
de chemin de fer reliant les villes d’Orange et de Buis-les-Baronnies devait
passer à proximité immédiate de l’angle nord-est du mur de scène. Les ruines
apparentes du théâtre furent protégées, cependant toutes les traces des
constructions antiques qui se déployaient au nord de l’édifice furent totalement
détruites.
L’arrivée du chanoine Joseph Sautel allait être à
l’origine de la redécouverte archéologique de l’édifice antique. Jeune prêtre,
nommé professeur d’histoire et de géographie à Avignon, il découvrit les ruines
de l’antique cité, qui allait très vite le passionner, et entama les premières
fouilles sur le site du théâtre en 1907, jusqu’en 1926, avec le soutien de Paul
Buffaven, alors maire de la ville, et avec l’aide
financière de Maurice Burrus. Peu après, s’appuyant sur les résultats des
fouilles du Chanoine Sautel, Jules
Formigé, architecte en chef des Monuments
Historiques, entreprend la reconstruction du théâtre qui s’achèvera en 1936 pour
livrer aux visiteurs une proposition de restitution.
 |
Le pont
Composé d’une
seule arche de 17 mètres et 9 mètres de large, il est ancré dans la
roche au niveau d’un rétrécissement de l’Ouvèze.
Sa construction remonte à la fin du Ier
siècle et malgré quelques restaurations, il reste un lien indestructible
entre la cité médiévale et la ville contemporaine. D’énormes blocs de
pierre calcaire provenant des carrières de Beaumont-du-Ventoux ont été
soigneusement taillés et assemblés à joints vifs pour constituer
l’arche. Jusqu’à la construction d’une passerelle un peu plus
bas au milieu du XIXe siècle, il était le
seul passage possible entre la Haute-Ville
et le reste de la vallée. Il a résisté vaillamment à une première crue
en 1616 et à la violence des flots lors de la crue de 1992. Aujourd’hui,
les plaies se sont refermées et les rives ont été réaménagées en espace
de promenade, tout le long de la ville jusqu’à une bambouseraie et le
jardin des Neufs Demoiselles. De nombreux badauds viennent encore comme
en pèlerinage contempler cette curiosité… Depuis cette catastrophe, l’Ouvèze,
qui n’est qu’un mince filet d’eau en été et qu’on avait oubliée, refait
partie de la cité. |
|
Le musée
Le musée Théo
Desplans, situé sur le site gallo-romain de
Puymin, a été construit entre 1972 et 1974.
Il expose au public les objets livrés par les fouilles archéologiques.
Des travaux ont été entrepris en 1998 afin d'agrandir et de rénover
entièrement le bâtiment existant. Le nouveau parcours muséographique, à
la fois chronologique et thématique, permet aux visiteurs de mieux
comprendre les lieux et de replacer dans leur contexte les objets
usuels, votifs ou funéraires. Dans la salle d'audiovisuel, des vidéos
commentent en continu les vestiges archéologiques. C'est un musée à
l'architecture moderne et aux moyens novateurs, pour que chacun découvre
les richesses archéologiques de Vaison-La-Romaine.
Ce premier
espace met en place les lieux et les peuplements avant la romanisation,
car l'entité Vasio existait bien avant l'arrivée des romains. Il donne
un bref aperçu de la préhistoire (jarre chalcolithique, maillet …).
Une carte des
sites préhistoriques sur la commune de Vaison a été établie à partir de
trouvailles souvent fortuites, et d'opérations de prospection. La
protohistoire est évoquée à travers le moulage d'un foyer domestique de
plein air, découvert sur la rive gauche de l'Ouvèze.
Plusieurs stèles en grès du VIème siècle avant J-C, funéraires ou
votives, sont présentées. Cette introduction permet de comprendre le
développement de la ville gallo-romaine et de savoir comment la
population voconce est passée de l'oppidum à
la vallée. |
 |
Ville gallo-romaine
Le
dégagement de 15 hectares de vestiges depuis le début du siècle et les
observations réalisées au cours des travaux d'urbanisme, ont apporté de
précieuses informations sur la ville antique. A son apogée (fin Ier - IIème
siècle après J-C), elle couvrait 60 à 75 hectares. Le centre-ville s'étendait
sur la rive droite de l'Ouvèze, qui était endiguée
dans sa traversée urbaine et bordée de constructions. Tous les grands axes ne
sont pas visibles en surface mais leur parcours est indiqué par l'importance de
leurs égouts. L'essentiel de Vasio demeure enfoui sous l'agglomération actuelle,
seuls des quartiers résidentiels, commerciaux et artisanaux ont été fouillés.
Quelques monuments publics complètent notre connaissance de la ville. Une
maquette présente le système de construction de l'endiguement de la rivière,
étudié en 1993 et 1996. Plusieurs pieux en chêne restaurés, sur lesquels
reposait la fondation en pierre, sont exposés.
Monuments publics
Cette partie présente des inscriptions d'hommes publics, ainsi que des éléments d'architecture de grands édifices, tels que des chapiteaux corinthiens. Tout un espace est consacré aux monuments des eaux : aqueducs, thermes publics, balnéaires. Des tuyaux en plomb qui distribuaient l'eau depuis l'aqueduc sont exposés, ainsi que des caissons à répartition d'eau ou chauffe-eau. Une vitrine présente plusieurs objets provenant des thermes (brique, lampe à huile, bille …).
 |
Théâtre
Une maquette,
ainsi que des photographies, présentent le théâtre antique avant et
après sa restauration de 1930-34. Les statues impériales en marbre, qui
ornaient autrefois le mur de scène, constituent un ensemble d'une grande
richesse, tant au niveau historique qu'artistique. Claude (empereur de
41 à 54) est représenté dans l'attitude de l'orateur, la tête ceinte
d'une couronne de feuilles de chêne. Domitien (empereur de 81 à 96) est
représenté avec une armure cuirassée. Hadrien (empereur de 117 à 138),
accompagné de son épouse Sabine en matrone de l'aristocratie romaine,
est nu (à l'exception du manteau couvrant son épaule), à la manière
hellénistique. D'autres sculptures en marbre, comme une tête d'Ariane,
complètent cette collection provenant du décor du théâtre.
Commerce et
Artisanat
Cet espace
présente les témoins des activités artisanales gallo-romaines, connues
en particulier par les fouilles du quartier des Boutiques à
Puymin. Une inscription mentionne le
regroupement en corporations d'artisans, commerçants et travailleurs.
Bourreliers et cordonniers transformaient le cuir, les tisserands, la
laine, et les tabletiers l'os et la corne. Une vitrine expose des pesons
utilisés pour le tissage et des objets en os. Une autre présente des
outils : serpe, marteau, pioche… Des pièces de monnaie et des amphores
témoignent de la vigueur des échanges commerciaux à cette époque. |
Religion
La
religion gallo-romaine se caractérise par une osmose entre le fond indigène et
les cultes romains voire orientaux. Dans le monde rural de Vasio, les cultes
liés à la fécondité, à la terre et aux hommes étaient essentiels, comme en
témoignent des inscriptions à des divinités secondaires dans le panthéon
classique.
Les voconces adoraient Mercure, Sylvain ou Vulcain…
Plusieurs autels sont dédiés aux déesses mères. De petits autels, dégagés dans
des habitations, illustrent la pratique d'un culte domestique.
L'une des œuvres les plus célèbres du musée de Vaison est une tête d'Apollon en
marbre, du IIème siècle. Il s'agit de la réplique romaine d'un original grec de
style classique.
Funéraire.
Cette partie du musée est consacrée aux pratiques funéraires : localisation des
zones sépulcrales, rites de l'inhumation ou de l'incinération. Elle présente des
stèles funéraires. Des objets usuels retrouvés dans les tombes témoignent des
pratiques funéraires : fioles à parfum, lampes à huile, miroir…
Maison gallo-romaine
Ce
thème est le plus représentatif à Vasio puisque la majorité des vestiges
concerne l'habitat privé. Une partie est consacrée à la cuisine, avec la
reconstitution d'un foyer et une vitrine présentant de la vaisselle en terre
cuite et en verre. Deux maquettes de la maison au dauphin mettent en évidence
l'évolution de l'habitat entre le Ier siècle avant
J-C et le IIème siècle après J-C. Une reconstitution partielle d'une toiture
antique informe le visiteur sur la physionomie architecturale des habitations.
Des éléments de décor intérieur, de mobilier, ainsi que des objets usuels
(bijoux, armes, jetons de jeux, miroirs) témoignent de la vie quotidienne.
Des peintures murales du IIIème style pompéien et une mosaïque de 33 m2
provenant de la villa du Paon complètent l'ensemble.
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Renseignements d'ordre général
Office de tourisme Site internet : www.vaison-ventoux-tourisme.com Email : contact@vaison-ventoux-tourisme.com Ouverture du site |
Comment s'y rendre VPC de la (des) médaille(s) au statut en vente OUI
Chèque à l'ordre de "Office de tourisme" |